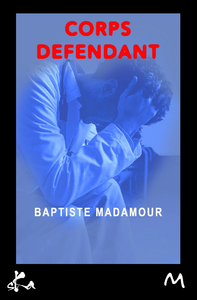Une fissure court entre deux pierres, le mur est gris presque noir, mes doigts suivent la fissure, du sang coule sur ma main, du sang coule le long du mur, un cri monte de mon ventre et s’arrête, j’accélère le pas, je ne sais pas où je vais, il fait nuit maintenant, je voudrais être ailleurs, au soleil, près de la mer, mes doigts s’écorchent sur la pierre, je n’ai pas mal, j’ai peur, je cours maintenant, le mur est haut, tellement haut, j’entends quelqu’un, il y a du sang sur le sol il y a du sang sur le mur il y a du sang sur mes mains, on me suit, je me retourne, un homme le visage caché par une écharpe, il tient une hache, une hache immense et rouge, je suis sur une dalle en marbre, allongé, des liens lacèrent mes poignées, mes chevilles, des liens qui creusent ma peau, je suis nu, l’homme tourne autour de moi, je veux hurler mais ça ne sort pas, rien ne sort de moi, je voudrais me recroqueviller, me resserrer, me retrouver en position fœtale, redevenir enfant, courir dans un pré en riant, poursuivre des papillons, et qu’on me prenne par la main, et la hache tranche ma cheville, je vois mon pied qui se détache, la hache s’abat sur mon épaule qui craque, se fend, je ne peux bouger, la hache dans mon ventre, m’éviscère.
Une fissure court entre deux pierres, le mur est gris presque noir, mes doigts suivent la fissure, du sang coule sur ma main, du sang coule le long du mur, un cri monte de mon ventre et s’arrête, j’accélère le pas, je ne sais pas où je vais, il fait nuit maintenant, je voudrais être ailleurs, au soleil, près de la mer, mes doigts s’écorchent sur la pierre, je n’ai pas mal, j’ai peur, je cours maintenant, le mur est haut, tellement haut, j’entends quelqu’un, il y a du sang sur le sol il y a du sang sur le mur il y a du sang sur mes mains, on me suit, je me retourne, un homme le visage caché par une écharpe, il tient une hache, une hache immense et rouge, je suis sur une dalle en marbre, allongé, des liens lacèrent mes poignées, mes chevilles, des liens qui creusent ma peau, je suis nu, l’homme tourne autour de moi, je veux hurler mais ça ne sort pas, rien ne sort de moi, je voudrais me recroqueviller, me resserrer, me retrouver en position fœtale, redevenir enfant, courir dans un pré en riant, poursuivre des papillons, et qu’on me prenne par la main, et la hache tranche ma cheville, je vois mon pied qui se détache, la hache s’abat sur mon épaule qui craque, se fend, je ne peux bouger, la hache dans mon ventre, m’éviscère.
Le drap colle à ma peau, je suis torrent, fleuve, je me tiens le ventre, la sueur inonde mon nombril, je me touche le front et essuie de grosses gouttes, mes mèches sont coagulées, je m’assois sur le lit, je me touche le bras, mes mains sont froides, ma peau est chaude, je touche mes épaules, mes jambes, mon sexe, tout est là. Une nausée me distord.
Les volets laissent passer la lumière du jour, par lanières. Je m’habille en me tenant au mur, je me sens bancal, mon slip, mon jean, je ne vais pas y arriver, ma tête tourne, je respire lentement, mon tee-shirt me semble glacé, j’en chie pour mettre les chaussettes, les chaussures, les gestes du quotidien sont souvent si difficiles, si fatigants. Ma tête tourne. Encore. Les murs sont spongieux, semblent couverts de mousse. Je ne me retrouve pas.
Je titube dans le couloir. Je suis poisseux comme au sortir d’une fièvre. Cette putain de maladie qui m’accompagne depuis si longtemps, cette putain de maladie.
Je me tiens devant la porte d’entrée de mon appartement. De mon si joli petit appartement. Je veux me vomir sur le palier. Mais je ne peux décemment pas sortir, l’ennemi est à l’extérieur. Partout. Dehors ça circule, ça va dans tous les sens. Je n’ai pas la bonne vitesse.
Je vais dans la salle de bain, je m’accroche à l’évier, je regarde le robinet qui ne cesse de goutter, rien ne fonctionne ici, ploc, ça m’angoisse, envie de taper ma tête contre la céramique, j’inspire, avale le maximum d’air, expire, ploc, je me regarde dans le miroir, je vois ma bouche déformée, mes lèvres qui sont attirées par le sol, mon aigreur, je me traite de sale con, de bon à rien, si tu savais à quel point je te déteste, si tu savais à quel point… ça ne me défoule pas, il m’en faut plus. Je m’asperge le visage, j’aimerais me rincer, l’eau ne peut atteindre les viscères, laver mes os, ma substance blanche, mon corps calleux, ma moelle épinière, tous ces morceaux… De la merde.
Je retourne dans ma chambre en traînant des pieds, en traînant des jambes, des épaules. Je m’assois sur le lit, tiens ma tête entre les mains. J’inspire, expire. Je me redresse, quelques secondes, un espoir puis m’effondre à nouveau.
Je m’allonge, je veux m’enfoncer, disparaître. Je touche quelque chose.
Une bosse sous une épaisse couverture, comme un long ver, des cheveux blonds émergent, un cadavre ? Je découvre le corps en tremblant. Une femme, une femme nue allongée sur le ventre, des fesses rondes sous un dos maigre aux vertèbres apparentes qui arrachent presque la peau, des fesses qui font un toboggan de chair, je n’ose toucher, j’approche ma main à quelques centimètres mais je ne peux aller à son contact. Je ne veux pas m’écorcher, ni l’écorcher.
Elle bouge. Je sursaute. Elle se retourne. Elle a des petits seins tout près des os. Elle étend ses bras, cligne des yeux, elle marmonne : « hum, j’ai bien dormi… ». Elle a de la chance, comment a-t-elle pu alors que j’étouffais là, juste là, à ses côtés ?
Elle se lève, met une chemise de nuit qui s’arrête à mi-cuisse.
Je la regarde, ses pieds nus et fins et le reste. Je la reconnais, je vis avec elle depuis des années.
Claire partage mon lit tous les soirs, partage mes nuits, pour ce qu’il y a à partager, il faut croire que je sais être supportable, que je sais faire bonne figure, faire semblant.
Elle ouvre les volets, le soleil entre dans la pièce, me brûle.
« Tu as mis ton tee-shirt à l’envers, on voit l’étiquette… », je ne réponds pas.
« Tu as mauvaise mine ce matin… » Tu ne vois donc pas. Tu ne vois pas que ça merde, à quel point ça merde de partout, toi, moi, mon travail et puis ce truc qui me bousille toutes les nuits. J’ai des difficultés à respirer, à m’exprimer, tu veux que j’extrais mon cerveau, que je l’arrache moi-même, tu veux en voir les crevasses, vas-y bouffe-le !
« Qu’est-ce que tu marmonnes… Tu n’as pas l’air dans ton assiette, dis quelque chose ! » Elle ne se rend pas compte. Si je commence à parler, si j’ouvre les vannes, alors tout va sortir, la gerbe et le reste, un flot ininterrompu, de quoi te noyer, il faut que je retienne, que je continue à construire le barrage, de plus en plus solide, de plus en plus épais. Je peux ainsi sortir sans risque, je ne vois rien, ne ressens rien.
Mais là je ne peux plus. Je n’y arrive plus. Je n’y arrive tout simplement plus.
Ça fait comme des vagues. Des souvenirs, moi au milieu de la cours, et le monde autour, moi avec un cartable tellement lourd sur mes épaules maigres, et puis tous qui s’amusent, et je les regarde, la cour est grande, je me rappelle, j’avais peur.
Un enfant rêveur, le maître disait que j’étais un enfant rêveur.
Elle se dirige vers la cuisine, je la suis à la trace, elle prend un bol, met du lait à chauffer, s’assoit. Je m’assois en face d’elle, ne la quitte pas des yeux. Je pourrais être un chien, j’aimerais être un chien. Je poserais ma tête molle sur ses jambes.
« Tu as acheté du pain ? », je ne réponds pas, « putain, tu avais promis », de quoi parle-t-elle ? Le pain, la boulangerie, dehors, je n’irais plus, c’est la guerre, l’hécatombe, la sauvagerie permanente. Je réponds pas. Je reste prostré sur la chaise.
– J’ai l’impression que je vais avoir du mal à te parler ce matin…
– Tu sais, je fais ce rêve toutes les nuits…
– Ce rêve… Quel rêve ?
– Ce rêve… toutes les nuits… il y a un type qui me poursuit sans cesse …
– Comment ça ?
– Un type qui me poursuit, qui veut me… le même cauchemar, je ne sais pas ça fait combien de temps que je le fais… je me demande si je ne l’ai pas toujours fait, comme une bête à l’intérieur qui me ronge…
– Je t’entends pas très bien, tu marmonnes…
– Je ne sais pas depuis combien de temps. Alors je dors mal… Il a une hache ou une autre arme, un truc qui coupe, qui tranche… Je ne sais pas quand ça a commencé la grande perturbation mondiale, je ne suis qu’un bout de la chaîne, une immonde petite merde, une merde parmi les autres merdes…
– Je comprends rien à ce que tu me dis…
– … Et toutes les nuits… il y a ce type… Je ne sais pas qui il est. Je ne vois jamais son visage. Ça peut être n’importe qui…
– De quel type tu parles ?
– Je me tais.
Et puis je dis
« Ça va. Ne t’inquiète pas pour moi. Il ne faut jamais s’inquiéter pour moi. Ça va. »
Elle ne dit rien. Elle ne semble pas convaincue mais elle fait avec. Elle se remet à manger, des biscottes puisqu’il n’y a pas de pain… Avec ce qu’il reste de beurre. Elle fait avec.
Je n’aime pas les petits déjeuners, me lever le matin, me lever tout court.
Il faudra qu’un jour je prenne les armes.
Elle passe sa main sur ma nuque pour me faire sentir qu’elle comprend que je ne vais pas très bien, qu’elle est là, qu’elle me soutient. Ses doigts sont glacés. Elle est peut-être morte. Je parle peut-être avec une morte. Elle sourit. Puis me dit d’une voix enjouée.
« C’était pas mal hier soir, non ? » Hier soir, de nouveau le brouillard, je ferme les yeux, rien ne me revient, je me concentre, ça crée une douleur, tout s’efface si vite, je me souviens juste de l’homme à la hache, avant c’est brouillé, on a regardé la télé, elle a dû me parler, j’ai dû lui parler de ma journée au travail, de mon travail…
« Tu ne vois pas de quoi je te parle… Heureusement que je ne me vexe pas facilement. Attends je vais t’aider… » Un jeu ? Trop cool, je suis totalement dans l’ambiance pour jouer aux devinettes, elle ne se rend vraiment pas compte. Elle continue ses efforts pour me faire penser à autre chose, je la vois gesticuler tout là-bas.
« Tu te souviens pas de cette table, moi dessus… » Elle prend une voix qu’elle doit imaginer coquine. Et puis ça me revient. Ses seins qui frottent sur la table, ses mains qui se retiennent aux bords, ses gémissements, ses fesses… et moi qui… Ça m’angoisse.
Je lui fais un sourire pour lui dire que ça va, je me souviens, et surtout qu’elle cesse ce jeu.
Mais elle se sent encouragée, elle pose sa main sur ma jambe, elle se penche, le tissu blanc se détache de son torse pâle, elle approche ses lèvres, je plonge ma main sous sa chemise, attrape son sein, et puis non, je ne veux pas.
Je la repousse.
« T’es vraiment chiant. » Un silence.
– Je suis désolée… Je voulais juste te changer les idées…
– Bien essayé.
– Hum, de toute façon on n’avait pas le temps, il va falloir que t’ailles au travail.
Le travail. Un immeuble blanc, une porte vitrée, un bureau, un ordinateur, et puis des gens, et puis je tape des lettres, des rapports toute la journée. C’est pour ça que suis debout. Pour aller travailler. Je ne veux pas qu’on me guillotine. Je n’ai rien fait, je suis innocent, cher Tribunal Révolutionnaire, j’ai toujours soutenu la cause, pourquoi vous voulez m’envoyer là-bas, j’ai jamais tué personne, je n’ai jamais rien fait de mal, j’ai toujours été un garçon bien élevé, poli, toujours tellement conciliant, il faut bien vivre en société, savoir vivre en société, je ne veux plus y retourner, je sais que c’est le lot de tous, que ça ne sert à rien de protester, pourquoi moi j’aurais une permission et pas les autres, je m’en rends compte, je demande beaucoup, mais je ne peux pas… Je vous jure.
Enfant, je rentrais à l’école primaire, j’avais six, sept ans, je me tenais aux portes, je ne voulais pas y aller, je m’accrochais à tout ce qui dépassait, on me traînait, je criais, je hurlais, je pleurais, je ne comprenais pas pourquoi… je me sentais arraché. Quand je raconte cette épisode à mes amis, ça les fait sourire, ils ne se rendent pas compte à quel point ça n’a jamais cessé. Le grand massacre.
Je ne veux plus aller au front.
Je veux déserter.
Il faut que je trouve un endroit où me réfugier, un placard, où alors sous la table mais ça ne suffira pas, on me retrouvera toujours.
Je me souviens hier au travail, un collègue, on dit comme ça, un collègue, à trois bureaux de moi, il m’a dit un truc désagréable, il a sous-entendu que je foutais rien, oh rien de grave mais tout m’a semblé tout d’un coup très instable. Tout s’effritait.
Ma vie.
Tout le monde fait ça, non ? Tout le monde se lève tous les matins, j’en vois en face, de l’autre côté de la cour, une fenêtre, de la lumière, il y a une famille, tous déjà debout, tous le nez dans leur café, leur chocolat, peu importe… Tous prêts.
C’est hier je crois que j’ai compris que je ne m’échapperais pas, je me disais toujours qu’à un moment je bifurquerai vers d’autres territoires, des prés, la verdure, une piscine, enfin je ne sais pas, des femmes amoureuses, le soleil, la mer, mais il n’y a aucune raison il faut se rendre à l’évidence, il n’y a aucune raison que ma vie change.
Alors tous les matins, la tuerie.
Je me souviens, je pleurais « je ne veux pas y aller, je ne veux pas aller à l’école… » j’avais six, sept ans pas plus, je ne sais plus ce qui me faisait peur… J’aimerais pleurais à nouveau, et qu’on vienne me rassurer « Ne t’inquiètes pas mon petit, mon tout petit, tout va bien se passer, tout va bien se passer… » Tu sais, si je m’engouffre à nouveau dans la boîte, l’usine, je n’en sortirais pas, ils me garderont, je ne pourrais jamais plus m’enfuir.
Je suis tétanisé, je ne bougerai plus, c’est fini.
J’avais six, sept ans pas plus et je comprenais que ma vie se résumerait à des murs, à des portes, à une prison douce.
Et j’entends sonner, Claire tressaille. Ils viennent me chercher, ils ne veulent pas que je reste, j’aimerais tant essayer de dormir, trouver la paix, ils ne veulent pas, c’est normal, je n’ai pas le droit. Je comprends tout à fait, ils veulent m’emmener au travail.
Je dis à Claire que je n’irais plus. Je me lève, je prends un couteau, un couteau de cuisine avec une longue lame tranchante. Je n’irais pas.
Je me dirige vers la porte d’entrée. J’ouvre. Deux hommes, ceux qui viennent me chercher. Un petit à lunette avec un gilet marron, un manteau pardessus, et un grand avec des sourcils épais, coiffé très propre, la raie sur le côté, comme un enfant qui aurait grandi d’un coup… J’avais six, sept ans, pas plus. Il a une écharpe sur le nez, une écharpe grise. Il fait froid dehors.
Je serre le couteau… Je ne les vois pas, les entend mal, mes yeux sont liquides, j’entends « est-ce que vous croyez en Dieu ? », le couteau se plante à la base du cou de l’homme au gilet marron, un jet de sang, ses yeux affolés… Claire crie… Ses mains fines couvrent sa bouche, elle me regarde effrayée, il n’y a pas de quoi, l’autre homme n’a pas bougé, il a laissé tomber son livre, une bible sur le sol.
Je retourne dans la chambre. Il y a du brouhaha dans l’entrée, cris et pleurs mêlés. Je me mets dans mon lit.
J’entends les bruits au loin, je sais que je ne vais pas aller au travail avant un bon moment, je mets la couverture sur mes épaules, je suis sur le côté, je prends mes genoux dans mes bras, les serre sur mon torse, du sang poisseux coule sur mes mains. Je me sens bien.
Si vous voulez partager