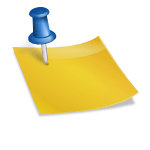J’ai rencontré Maurice Attia pendant la Cambuse du noir de Valence qui se déroule juste avant le printemps tous les ans.
BM : Comment êtes-vous arrivé au roman noir ?
Maurice Attia : Parce que le premier livre que j’ai lu dans ma vie, c’était un polar, ça s’appelait Le rouge est mis de Le Breton je crois, j’ai commencé à lire tard, je lisais des fanzines quand j’étais petit et puis un jour il y avait une caisse de livre dans ma chambre, le deuxième c’était Bouvard et Pécuchet de Flaubert et après le théâtre de Sartre… Et mon boulot c’est de faire des enquêtes de toute façon sur les gens (NDLR : Maurice Attia est psychiatre, psychanalyste), donc c’est un genre qui m’attirait, puis il y a eu des auteurs comme Goodis, Thompson qui m’ont beaucoup, beaucoup passionné, et mes références dans la littérature noire, c’étaient ces deux bonshommes là, il y a eu d’autres bien évidemment…
BM : Est-ce que vous pouvez me parlez des livres précédant Alger la Noire ?
MA : Ce qui m’intéresse c’est toujours les gens, l’humain, et les périodes dans la vie où les choses basculent, du fait d’un grain de sable… Rue Oberkampf c’était ça parce qu’il y a de la spéculation immobilière et des gens qui défendent leur territoire, comme des indiens par rapport aux cow-boys, en gros. Pour moi c’était un conte policier ce livre, parce qu’il n’y a pas de mort. Il y a juste des embrouilles, des arnaques et un personnage féminin qui était donc Mathilde et qui a été formé par un vieil arnaqueur à ce métier. Elle est assez formidable comme personnage parce qu’elle roule tout le monde dans la farine, mais à un moment donné, il y a une bande beaucoup plus dure, et là, elle s’en prend plein la gueule… Le carnaval des gueux c’est parce que je suis de la génération de 68 et c’était la révolte des esclaves, c’est ce qui s’est passé dans les banlieues là, les gens en ont plein le cul et ils se révoltent d’une manière merdique et là encore c’est une femme qui est de passage par là qui les organise et ils foutent un bordel noir dans la ville pour faire entendre leurs revendications, ça c’était le deuxième. Et là Alger la Noire c’est une histoire beaucoup plus personnelle, je suis d’origine pied-noir et je voulais traiter de cette période là, à la fin de la guerre d’Algérie, plutôt que de le faire romanesque classique, j’avais envie qu’un lectorat de polar puisse découvrir cet univers là et la guerre civile en général et par ailleurs, que les gens qui s’intéressaient à l’histoire de l’Algérie puissent découvrir le polar. Je voulais qu’il y ait une double lecture possible et je suis assez content du résultat parce que j’avais un peu la trouille qu’on me cartonne de tous les côtés. Ce n’est pas le cas, les gens qui ont vécu ça, que ce soit des Algériens ou des pieds noirs, y ont retrouvé l’atmosphère et la folie urbaine de l’époque et ont trouvé que c’était assez fidèle et des amateurs de polar ont découvert l’Algérie. Des personnes de trente, trente-cinq ans qui connaissaient ça à travers le bouquin de terminale d’histoire-géo connaissaient pas du tout en réalité la violence de cette guerre civile, puisqu’on a fait en sorte de parler d’évènements, alors que c’était une vraie guerre, une vraie guerre civile…
BM : Ce qu’on connaît moins c’est cette dernière période…
MA : Comme toujours c’est la plus folle parce que tout le monde tue tout le monde en général dans les fins de guerre, c’est une période dérangeante qui dérangeait autant les Algériens que les Français, donc on l’a un peu zappée. En gros, sur la dernière période il y a trois choses qui sont restées émergentes, il y a la débâcle des rapatriés qui sont arrivés en masse en France, le massacre des harkis et la prise de pouvoir par le FLN en Algérie, en gros ça a été ça, on n’a pas beaucoup plus parlé du reste. Moi ce qui m’intéressait c’était de traiter ce reste, c’est pour ça que j’ai fait le choix de la polyphonie, je voulais avoir des regards différents sur la même période et traiter du quotidien de la guerre civile, à savoir que c’est pas parce qu’on meurt autour de soi que la vie s’arrête, les gens continuent à vivre, à aimer, à s’engueuler, enfin la vie continue et c’est essentiel, de continuer à vivre, sinon on reste terré, on devient fou, quoi ! Voilà c’était ça l’idée ! Et puis l’idée était aussi de montrer à quel point on est prisonnier de sa généalogie, que son histoire peut amener à faire des choix qu’on croit autonomes et indépendants mais qui sont liés à l’histoire d’où l’on vient. C’est pour ça qu’il y a un juif pied noir, un espagnol dont le père était républicain, une française d’Orléans qui appuie son histoire familiale, et des bourgeois qui étaient au départ fils de communards et qui ont basculés côté extrême droite, donc c’était cette idée là que je voulais traiter et donc qu’il y ait des points de vue différents selon les individus…
BM : Est-ce qu’il y a une volonté que ces personnages, en tout cas au début, qu’ils ne veulent pas prendre parti, est-ce que c’était nécessaire pour…
MA : C’était parce que tout simplement moi j’ai vécu cette période enfant, et enfant je ne prenais pas parti dans ma tête. Je constatais tout simplement que les adultes devenaient fous, tous, même les plus sympathiques, les plus attachants, les plus doux pétaient les plombs. Je voulais avoir ce regard là cette fraîcheur là mais dans l’esprit d’un adulte, ça n’a pas été facile, il fallait qu’il y ait quelque chose qui justifie qu’ils ne prennent pas parti. Et j’avais lu une ou deux histoires sur les règlements de compte, entre républicain espagnol, les trotskistes et les anarchistes d’un côté, les communistes de l’autres et je me suis emparé de ça pour justifier de la mise à distance de mon héros. Il a eu un père, lui a-t-on dit, qui a été anarchiste et liquidé par les communistes. Il se dit que vraiment prendre parti ce n’est pas un bon plan, et il refuse de s’allier à quelque idéologie que ce soit. Ce qui le passionne c’est le cinéma et le boulot de flic, et il espère le faire bien, son boulot de flic, et comme à ce moment là, plus personne ne fait son boulot, y compris les flics, il décide de s’attacher à une enquête pour survivre psychiquement, mentalement, pour échapper à la folie environnante alors il y parvient, mais on n’échappe pas au contexte dans lequel on évolue, alors il se fait rattraper. L’idée était celle-là, c’était de garder un point de vue de quelqu’un qui n’avait pas un discours partisan et avait un regard presque cynique par moments sur les choix des hommes et des politiques. Ce que profondément je crois, parce que je suis persuadé que les gens de pouvoir roulent avant tout pour eux, et non pas pour les gens pour lesquels ils sont supposés militer et ils sont prêts à tout, y compris sacrifier des population, etc. pour arriver à leur fin, donc je suis très sceptique là-dessus. Qu’est-ce qui vous a intéressé, vous, interview à l’envers ?
BM : J’ai beaucoup aimé la construction, j’ai beaucoup aimé le mélange entre les histoires personnelles et la grande histoire, cette friction. Une question que je me suis posé, il y a plusieurs personnages, il y a le pied noir…
MA : Il y a Paco Martinez, il y a une femme d’origine Orléanaise… Il y a la grand-mère de Paco qui a fuit le franquisme avec son petit enfant. Et puis il y a des personnages secondaires comme la famille Thévenot, fils de communards devenus grands bourgeois, dont le père est passablement tordu et son fils est devenu OAS, un peu comme son grand-père, a fait les barricades, etc. mais comme son grand-père, les barricades mais du mauvais côté parce que l’un et l’autre se sont fait étriller dans l’histoire. En tant qu’ancien gauchiste, j’ai connu des types dont les pères étaient fachos qui étaient gauchistes pour faire chier leur père, et l’inverse, des mecs dont les pères étaient communistes qui sont devenus extrême droite pour faire chier leur père aussi. Il y a cette idée que la réaction peut amener à faire des choix qui sont pas toujours judicieux mais qui embarquent et puis il y a aussi traiter le petit peuple algérien, des femmes de ménage, des concierges, des qui ont tenté l’intégration telle que Abbas le fils qui a été tué au début de l’histoire, son père qui est tué aussi. Ce sont des gens qui ont joué la carte de l’intégration mais qui y ont laissé leur peau aussi, donc quelque soit la carte que vous jouez, on peut y laisser la peau, c’est aussi ce qui détermine le choix de Paco, finalement quelque soit le camp qu’on choisit, autant ne pas choisir, ce n’est pas la peine…
BM : justement parmi les personnes qui parlent réellement, il n’y a pas l’envie de faire parler quelqu’un qui fait partie de ceux qu’on appelait « les Indigènes » ? La question s’est posée ou non ?
MA : Oui bien sûr, bien sûr, mon problème au niveau des Algériens, j’aurais pu les faire parler, d’ailleurs je les fais un peu parler par la voix de Choukroun, parce que je les ai connu enfant aussi, de manière très proche. J’avais des petits camarades algériens, je vivais dans une maison où il y avait que des algériens quand j’étais tout petit, mais dans ce cas là il aurait fallu traiter de la période d’avant, j’ai connu ça entre 49 et 54-55, et comme je ne traitais pas de cette période là… A ce moment là Bab-el-Oued était un ghetto « blanc », ce pays étant à cette époque très communautariste, les gens pouvaient vivre ensemble, etc. mais quand il y avait des fêtes, des histoires, les espagnols se retrouvaient avec les espagnols, les italiens avec les italiens, et du coup Bab-el-Oued qui était au départ un ghetto communiste a basculé du côté de l’extrême droite, pas du tout par idéologie mais parce que pour la plupart des gens, c’étaient des gens d’origines modestes, des prolos, etc., et ils voulaient pas se barrer, et notamment les espagnols, qui se sont tirés d’Espagne virés par Franco et on se fait encore virer alors qu’on fait pas de mal, on travaille, on vit, c’est pas juste, et ils adhéraient à cette cause d’un manière très cinglée et en même temps désespérée, on n’a pas envie encore une fois, et du coup il n’y avait pas dans ce quartier d’Alger… comme l’OAS menaçait de mort tout Arabe qui travaillait ou qui vivait dans ce coin là, ils sont tous partis dans leur quartier à majorité Arabe pour éviter de se faire flinguer, au départ il y avait les mecs qui se sont fait flinguer, quand les mecs se sont fait flinguer, ils ont envoyé leur femmes, elles se sont fait flinguer aussi, après il fallait vraiment avoir le goût du risque pour traîner dans ces contrées là, ainsi il y avait les quartiers où les blancs étaient, les quartiers où les arabes étaient. C’est un peu comme aux Etats-Unis maintenant, il y a des ghettos comme ça, les Américains disent un truc très bien, le bourgeois qui va traîner dans le Bronx pour acheter de la coke, s’il se fait flinguer, tant pis pour sa gueule, quoi, il savait qu’il ne fallait pas y aller, et le black qui va essayer de cambrioler un appartement bourgeois, et s’il y a une police privée, et s’il se fait flinguer, il le sait aussi, et c’étaient des univers comme ça, très clivés, et c’est souvent ce qui guette… je hais le communautarisme, et je suis persuadé que ça a un côté très folklorique, très sympathique comme ça mais quand les situations se raidissent, ça bascule dans l’horreur, dans la haine, et là c’était ça, tout le monde basculait dans la haine, donc j’ai préféré le traiter en termes réalistes, à savoir qu’il n’y avait pas d’arabes, il y en avait au départ, mais ils se sont tirés… Quoi d’autre ? C’est bon ?
BM : non il y a une chose que je voulais savoir c’est sur la construction proprement dite, le fait qu’il y ait plusieurs voix, qui arrivent parfois dans des chapitres différents, parfois dans le même paragraphe, est-ce qu’il y avait une volonté de perdre les gens ?
MA : Oui, c’était un exercice difficile parce qu’il fallait que ce soit identifiable, on m’a reproché que Choukroune parle un français verbal, une langue qui n’est pas très belle mais ça été un choix, difficile d’ailleurs parce qu’il fallait qu’il ait un discours simple, pour qu’on l’identifie rapidement. Chacun des personnages a une tonalité qui m’obligé à les faire identifier rapidement pour qu’on passe de l’un à l’autre sans qu’il y ait de confusion possible, et moi ça m’intéressait parce que c’est l’entre-deux, parce que par exemple on est tous les deux dans cette salle, et comment toi tu peux percevoir les choses, tu me donnes ton avis et moi je vais continuer ce que tu racontes à ma façon, et c’est pas tout à fait la même chose. C’est pour ça que c’est toujours à la première personne, si j’avais été un narrateur que je faisais parler mes personnages à la troisième personne, j’aurais été tenté d’analyser les personnages, de les commenter et je voulais (il tape sur la table du doigt) que ce soit du brut. Je voulais que ce soit pas élaboré, je voulais que ce soit de la pensée comme elle se présente, et pas qu’elle soit construite, explicative, ou commentée et pour ça il fallait la première personne, et parlant à la première personne, il me fallait une fluidité qui me permette de passer d’un personnage à l’autre à travers le récit. J’ai essayé de faire en sorte que ça le fasse le mieux possible et c’était important pour moi qu’il n’y ait pas de commentaires, qu’on soit dans l’intuitif, dans le subjectif, et surtout pas dans l’objectif, le rationnel, je ne voulais pas de ça, je voulais plus des sensations, des émotions que des explications… Je ne sais pas si ça été réussi, on m’a fait deux, trois critiques là-dessus en me disant que ça aurait mieux si ça avait été un vrai roman avec des personnages décrits, présentés, etc. Je n’ai pas voulu ça…
BM : moi je préfère qu’on bascule, même s’il faut deux, trois lignes pour qu’on comprenne qui parle…
MA : Ouais, et en même temps tu te prives de tous les commentaires, quand tu as un narrateur tu peux parler du personnage qui arrive dans un lieu, avec des tables, des machins, etc. quand tu es humain tu ne penses pas les choses comme ça, tu te dis pas « j’arrive dans un lieu qui est ainsi et ainsi, tu te dis j’arrive dans une grande salle où il y a beaucoup de monde », et tu décris pas ce qu’il y autour de toi parce que tu t’en branles un peu, quoi ! Et moi je ne voulais pas de descriptif, je voulais que l’atmosphère de cet univers passe à travers le vécu et non pas le regard clinique, je dirais presque, et c’était un défi parce que c’est pas du tout évident. J’ai redouté que les gens se perdent, qu’ils se disent « on arrive pas très bien », c’est aussi pour ça que j’ai mis une carte à la fin, moi j’ai adoré ce qu’a fait le graphiste, parce que peu de gens ont remarqué mais il a fait la carte et il a rajouté des petits pointillés qui sont les trajets que prend le héros a travers la ville, t’avais pas vu, hein ! Voilà et c’est par là où il passe dans les différents épisodes de l’histoire pour que les gens se repèrent, c’est marrant, il est passé par là, puis là, ha ouais d’accord, voilà pour qu’il y ait une géographie urbaine sans qu’il y ait besoin de la décrire, ou de la raconter, soit il donne que les noms des rues et si on les connaît pas, on les connaît pas, donc c’était difficile de s’y retrouver et j’avais rajouté ça et l’éditeur était d’accord…
BM : Sinon il y a des projets ?
MA : Il y a une suite en cours qui se passe en 67-68 à Marseille et où on va retrouver Irène à Aix en Provence et Paco à Marseille et ça va traiter de ce qui a fait le lit de 68, non pas des barricades, des choses comme ça qui ont eu lieu essentiellement à Paris mais justement le contexte socio-politique de 67 qui est passionnant, parce que c’est la guerre des 6 jours en Israël, la mort du Che, la guerre du Vietnam, les conflits sociaux qui montaient de plus en plus et qui étaient brisés, et le planning familial. Je traite du contexte dans lequel 68 va apparaître, à travers une histoire policière apparemment comme celle-là anodine, mais qui ouvre sur des horreurs et notamment sur le SAC qui était à l’époque à Marseille, un mélange à la fois de Gaullistes purs et durs genre Pasqua etc. et de mafieux locaux qui se sont embarqués là dedans et qui ont fait des tas de saloperies. Il y a peu de gens qui savent par exemple que le SAC, comme au Chili sous Allende, avait prévu si les choses tournaient mal en 68 de rafler les syndicalistes pour couper la tête du mouvement… Ce qui est extraordinaire à Marseille c’est qu’il y a eu aucune violence parce qu’il y avait un maire qui s’appelait Deferre qui chaque fois qu’il y avait une manif qui risquait de dégénérer, se mettait au milieu avec ses conseillers municipaux avec son écharpe. Il jouait aussi de ça d’un point de la vue de la Province et pas de Paris « ha les barricades Gay Lussac… » justement voilà, il y avait un mouvement fort, la grève générale et tout ça mais il y avait un maire qui se la jouait « je refuse que ça dégénère » et il se mettait réellement au milieu. Moi qui était du côté des manifestants, je le détestais parce qu’il m’empêchait d’aller à l’affrontement et en même temps je l’admirais, je me disais il est courageux, parce que c’était un mec de soixante balais qui se mettent comme ça entre CRS et étudiants, il fallait avoir un certain courage et il a réussi à maintenir sa ville sans affrontement violent entre étudiants et CRS. Je veux parler de tout ce contexte, et y compris de la condition de la femme, à l’époque, donc c’est en cours d’écriture, je ne sais pas quand je livre mais bon, et là aussi ce qui m’amuse comme j’ai vécu longtemps à Marseille, c’est que je pense qu’il y a des Marseillais, un peu comme pour Alger, qui vont redécouvrir Marseille qui n’existe plus. Ayant vécu dans des quartiers populaires, notamment la banlieue Nord, qui est aujourd’hui considéré comme le Bronx, à l’époque, ce n’était pas ça du tout, c’étaient des HLM machins, mais c’était plutôt convivial et plutôt sympathique, et tout une partie de la ville qui était vivante a disparu, les cinémas ont disparu, etc. Je pense que seuls les vieux marseillais se souviendront de ces lieux, et de ces épisodes. Je voudrais revisiter ça un petit peu, et puis après on verra.