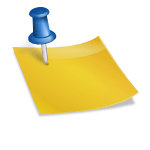Je rencontre Hervé Le Corre aux Quais du polar de Lyon, il répond avec modestie et passion pour un entretien où sont évoqués Jean Vautrin, Lautréamont, la question du deuil, de la violence, les choix d’écriture, le roman noir français…
Hervé Le Corre : Je suis arrivé au roman noir par mes lectures, j’ai commencé à lire des romans noirs à partir d’une trentaine d’années. Jusque là j’avais une formation plutôt ordinaire et classique. J’ai commencé à lire les grands américains Hammett, McCoy, Jim Thompson, des français surtout Manchette et Vautrin. Dans les années 80, à l’époque de gloire du néo-polar, ça correspondait à ce que je cherchais comme lecture à la fois au niveau des écritures, du style, fort, puissant et des préoccupations, le reflet de la société dans sa violence, dans ses tensions, etc. j’avais envie de dire ça. C’est venu assez bêtement, le désir d’écrire qui rencontre des lectures qui m’ont comblé.
Baptiste Madamour : vous avez commencé par la trilogie bordelaise ?
HLC : j’ai commencé par des romans qui se situaient à Bordeaux, que j’ai proposé à la Série Noire qui les a pris. Ils ont une unité de lieu pour la ville, avec des histoires et des thèmes complétement différents. Bordeaux c’est parce que c’est ma ville natale, c’est là où je travaille, et ça m’était plus facile de visualiser le cadre.
BM : J’ai l’impression que vous reprenez l’idée que le roman noir est un roman des perdants, être du côté des « petits » …
HLC : J’aime bien l’expression de Pierre Sansot qui parlait des gens de peu. J’aime bien cette image des gens de peu, et c’est à côté de ces gens-là que j’ai envie de raconter des histoires, de leur côté. Ce qui implique un engagement, à la fois littéraire parce que le point de vue narratif va être de leur côté, et un engagement plus général, plus politique sans faire pour autant du polar politique ou de dénonciation. Des récits à hauteur d’homme de préférence et du côté des gens qui prennent le pire de la violence dont je parlais, qui sont constamment soumis à cette violence, qui en sont victimes. L’idée du roman noir, il me semble c’est qu’à un moment ces gens essaient de réagir, les personnages qu’on invente essaient de réagir à un moment donné à cette violence, ça se passe bien ou mal, en général ça se passe mal, donc ça donne des intrigues fortes. La réaction à cette violence, c’est aussi des gens qui se trompent de colère, de violence, c’est à dire en le disant bêtement, il est rare que les pauvres s’en prennent aux riches. La plupart du temps c’est la voiture du voisin qu’on fait brûler, c’est la pauvre vieille qu’on va attaquer, c’est le genre de conneries que font les gens qui s’en prennent à plus faible qu’eux ou alors aux voisins qui sont tellement semblables que ce n’est pas si grave. On a l’impression que symboliquement il n’y a pas cette conscience minimale de classe de s’en prendre à ceux qui possèdent, il y a aussi les grands braqueurs, ce genre de chose, mais ils ont la conscience politique d’une laitue et ce n’est pas très intéressant à raconter. Je trouve plus intéressant de raconter une violence qu’on fait subir à ses semblables ou aussi qu’on peut retourner contre soi. J’aime assez comme lecteur ou pour les inventer, des personnages un peu auto-destructeurs ou qui sont là à courir tous les risques possibles, à se faire du mal, parce qu’ils ne savent pas contre quoi retourner cette révolte charnelle et tripale qu’ils peuvent ressentir.
BM : Quand vous commencez un livre, vous partez sur des personnages ? J’ai l’impression que c’est ça le pivot au début, ils ont une fêlure, une violence…
HLC : Oui ce sont plutôt les personnages qui me guident au départ, une vague histoire bien sûr mais surtout un type de personnage avec un devenir en puissance qui va devenir l’intrigue. Je pars plutôt de ça, c’est vrai, du coup j’essaie de fabriquer des personnages un peu forts, denses. Creuser leur profondeur, ce sont mes intentions, essayer d’éviter les archétypes, les clichés, les choses qu’on retrouve un peu trop souvent…
BM : Est-ce que c’est le cas pour L’Homme aux lèvres de saphir, ou c’est une volonté de montrer une époque où le peuple aurait peut-être pu faire quelque chose…
HLC : C’est une exception dans ce que je suis en train de décrire, parce que justement je ne suis pas parti d’un personnage mais je suis parti de la biographie très lacunaire de Lautréamont quand il revient à Paris dans les années 1868, 69. L’idée, c’est comment combler ces lacunes, comment réinventer une sorte de biographie, pas une biographie de Lautréamont parce que finalement il n’est qu’un comparse dans le bouquin mais comment utiliser ça et faire proliférer autour une intrigue. Avec la fascination pour une époque où le rêve était encore permis, actif et fort, comme par hasard, avant la commune, période pour lequel j’ai une fascination, je pourrais dire un amour particulier… il s’est passé en France à cette époque-là quelque chose de complétement singulier, je crois, dans l’histoire en Europe. C’est peut-être la seule révolution, même si elle a été battu militairement, c’est peut-être la seule vraie révolution qu’on ait vue, peut-être parce qu’elle a été battue, mais qui n’a pas donné lieu à des choses qu’on désapprouverait, mais peu importe, je ne vais pas faire l’analyse de Marx. Au départ j’aurais aimé écrire un roman noir qui se serait passé pendant la commune, mais le problème c’est que quelques années auparavant Vautrin avait écrit Le cri du peuple, c’est un énorme bouquin avec la dynamique du roman feuilleton, très très beau. Je me suis dit que je ne vais pas monter sur le ring avec un poids lourd pareil, je vais me prendre une branlée donc après pas mal de gestation du bouquin, j’ai pris la période qui précède avec Lautréamont qui est jeune homme à Paris, j’ai inventé cet avatar de Maldoror, le personnage central des Chants de Maldoror. Un avatar humain criminel qui va essayer de mettre en application les idées du livre, les meurtres décrits et dieu sait qu’il y en a et qu’ils sont violents dans les Chants de Maldoror. Je suis donc parti d’un concept, j’aime pas trop le mot, ça fait un peu prétentieux mais c’était ça l’idée. Les personnages ont ensuite envahi l’histoire, ils ont émergé, et j’ai tenté de les creuser, de ne pas en faire non plus l’archétype, genre l’ouvrier révolutionnaire, la proie prostituée, même si ça peut se réduire à ça par moment, j’ai essayé de leur donner du poids et de la densité.
BM : Est-ce qu’il y avait l’idée par rapport au roman noir que Lautréamont décrit le premier serial-killer, je ne sais pas si c’est le premier, mais…
HLC : Oui il met en scène une sorte d’image du mal, d »incarnation du mal, et quand on parle de roman noir, Isidore Ducasse, Lautréamont a lu et réutilise les romans noirs de l’époque, cette tendance des romans noirs gothiques, qui ne recouvraient pas tout à fait la même chose qu’aujourd’hui. On le sait, il a beaucoup lu ces gens, et le chant 6 en particulier, le dernier chant, met en scène un tueur qui suit sa cible avec une géographie de Paris très très précise, etc., ça c’était la rencontre entre mes intentions et celles de Lautréamont, c’était intéressant. Du coup, le tueur, il vient naturellement, un tueur en série que j’invente. J’ai beaucoup bossé sur la criminologie de l’époque et on sait qu’à cette époque là, il en existait, il y a toujours eu ce genre de prédateurs dans la nature, dans la société, mais le problème c’est qu’on ne faisait pas les rapprochements et la violence était tellement plus répandue, tellement plus banale qu’aujourd’hui, les crimes infiniment plus barbares contrairement à ce qu’on pourrait penser, on nous serine avec une augmentation de la violence alors qu’on sait qu’au XIXème siècle, en particulier dans les villes, vu la misère galopante qui y régnait, il y avait énormément de violence, des meurtres étonnants, bizarres, cruels et très peu de résolutions, on arrêtait assez rarement les criminels.
BM : Est-ce qu’il y a l’idée que le serial-killer est un petit joueur par rapport à la guerre qui suit et l’État qui va réprimer la population, etc. C’est horrible ce qu’il fait mais par rapport aux horreurs de la société…
HLC : je dois avouer un truc, c’est que ça, je l’ai emprunté à un film, ça m’avait frappé, ça s’appelle C’était demain de Nicholas Meyer, c’est un film des années 70. Le film et le bouquin sont biens, c’est la rencontre entre Jack l’éventreur et H-G Wells, Jack l’éventreur, vient de faire un crime dans le quartier, il s’échappe dans une machine à remonter le temps et se retrouve à Los Angeles dans les années 76. Très vite il s’adapte à la modernité, à la violence de la société américaine, un jour Wells le retrouve dans sa chambre d’hôtel lui dit que c’est horrible ce qu’il a fait, c’est barbare, etc. et l’éventreur allume la télé, il y a les infos qui passent et il y a une série de massacres, de bombardements… et il lui dit « mais attendez vous me reprocher quoi, mais je suis un amateur à côté de ça, je suis un petit bonhomme, vous ne vous rendez pas compte, allez dégagez, ce monde est le mien », et ça m’avait frappé. Il y a très longtemps que j’ai vu le film. A un moment donné, j’invente une scène d’émeute dans la rue à Paris, avec l’artillerie qui tire, et le tueur est fasciné par la capacité de destruction des armes modernes, il utilise aussi un revolver, un des premiers qui pouvaient exister à l’époque, quand il voit la potentialité de destruction de cette arme, lui qui travaille à l’arme blanche, ou c’est plus compliqué, il se met du sang partout… Il le dit lui-même il annonce un monde nouveau où ce genre d’acte serait banal. J’ai essayé de ne pas mettre d’anachronisme, de ne pas trop délirer, je me suis beaucoup documenté, mais cette mise en perspective là m’intéressait, ce type là est une espèce de précurseur, de prophète par l’acte…
BM : Pour le livre suivant Les cœurs déchiquetés, en plus des personnages, il y a l’idée de deuil, par rapport à d’autres romans noirs, là, les morts ont une importance, les disparitions ont une importance.
HLC : Il y a les morts et les survivants, vivre après la mort de quelqu’un qu’on a aimé, est-ce que c’est encore vivre ? En tout cas pendant un certain temps c’est survivre le temps que le deuil s’organise. Les survivants sont dans la pensée permanente de l’être disparu et dans ce bouquin j’essaie de faire en sorte que les disparus, les morts continuent d’être présents, l’urne qui contient les cendres de sa mère que le gosse garde, ou le flic qui continue de parler avec son gamin, qui croit le voir, qui continue de le chercher, persuadé que… comme il n’y a pas corps, il n’y a pas deuil possible pour lui, oui c’est un travail, c’est un bouquin sur le deuil, c’est évident…
BM : Ce qui est intéressant, c’est qu’il n’y a pas de cynisme dans la façon de regarder les gens…
HLC : Je crois que j’ai mis de la compassion…
BM : La mort de la mère a vraiment de l’importance…
HLC : Oui il ne s’agit pas de liquider cette femme comme ça, d’en faire un motif sanglant de roman noir, ça ne m’intéressait pas d’aligner les cadavres comme par exemple les histoires de tueur en série. Pour faire une parenthèse, les grands romans sur les tueurs en série sont des romans où tout à coup il y a un arrêt de l’enquêteur devant un cas, je pense par exemple à J’étais Dora Suarez où l’enquêteur, de Robin Cook, qui en a vu d’autres, s’identifie à cette fille et va aller au bout de son enquête, c’est ça qui sort à un moment donné ces romans du banal, je crois, et ici ce n’est pas une histoire de tueur en série, je n’aimerais pas en écrire, quoique je ne jure de rien, mais oui le deuil, la permanence de la vie… Les cœurs déchiquetés c’est tiré d’un vers de Léo Ferré, c’est les cœurs déchiquetés qui parlent aux fantômes. Mes deux personnages continuent d’avoir avec leur mort une espèce de commerce par la pensée, par des visions, par le souvenir, etc. qui font que par moment, ils sentent, et j’ai fait en sorte que le lecteur aussi le sente, ils sentent une présence fantomatique. Je ne crois pas aux fantômes et je n’ai pas voulu écrire un livre fantastique mais il est clair que dans fantôme, il y a fantasme, il y a création de l’imagination, du souvenir, de la douleur, et les fantômes parce qu’il est impossible d’avoir perdu quelqu’un qu’on a beaucoup aimé sans l’apercevoir dans la rue quelques semaines après… quelqu’un dans ma famille m’a fait ce genre de récit, en plus j’étais en train d’écrire le livre et ça m’a bouleversé, c’est ça que je veux dire, ce que ce gars là me raconte, c’est ça que je suis en train de creuser, c’est ça que j’essayais de faire…
BM : il me semble que les fantômes ça passe aussi par la présence de la nature, au début très sombre et après très douce avec l’enfant qui est dans sa maison, etc.
HLC : Oui après… c’est un roman noir qui s’éclaircit peu à peu, ça reste très noir… ça s’éclaircit, ça s’élargit, parce que je fais dériver le gamin sur l’estuaire de la Gironde, géographiquement, c’est un peu comme si le Styx, le fleuve de la mort ou des enfers devenait autre chose et débouchait sur la pleine mer, sur la lumière et sur des nuits apaisantes. Ça c’est la dernière partie du livre et c’est vraiment ce que j’ai écrit avec le plus de plaisir, vraiment ce sont des passages que j’ai écrit facilement alors que le reste m’a demandé beaucoup de peine, et là je savais que ça marcherait, que l’écriture fonctionnerait jusqu’au bout. Il y a tout à coup cette lueur, ce surgissement, et la nature aussi parce que mes personnages lui trouvent presque toujours des points rassurants. Je suis très sensible à la lumière, je regarde beaucoup les choses et il y a des moments où elle peut être aveuglante suivant l’état où on se trouve nous-mêmes, alors les personnages c’est un peu pareil, suivant l’état où on se trouve elle peut être insupportable et aveuglante ou bien apaisante ou elle va nous réchauffer. J’aime bien ce contact un peu sensitif, sensuel avec la nature, pas la nature écolo mais la nature qui nous entoure quand on sort de la ville, on entend le vent, le bruit des oiseaux, les bêtises de ce genre là qui font que tout à coup il y a autre chose que la dureté du béton, des pierres et du macadam.
BM : Est-ce que vous utilisez toujours cette construction de plusieurs voix différentes pour créer un ensemble ou…
HLC : Ouais j’aime bien ça. Sauf le premier La Douleur des morts qui étaient mené à la première personne par un narrateur unique… Pour les autres j’ai fait une espèce de montage parallèle avec des points de vues narratifs différents, j’aime bien éclairer comme ça… éclairer oui, comme sur une scène de théâtre ou au cinéma, tout d’un coup on donne du volume, c’est une technique pratique pour ça, et à l’écriture c’est intéressant, ça évite la lassitude, finalement on est content de finir le chapitre et ça redémarre, il y a une petit excitation du début qui se refait, c’est intéressant…
BM : Est-ce que vous avez essayé d’adapter le style d’écriture à chaque personnage ?
HLC : Pour le dernier j’ai… (un lecteur vient faire dédicacer son livre, ils échangent, puis une autre personne puis on reprend la discussion)… C’est compliqué à dire, comme ce n’est pas eux le narrateur c’est moi qui continue de faire le boulot, je garde une manière, une rythmique des phrases qui est quand même la même, qui est tout de même semblable. Mais comme en littérature, je ne vois pas comment on peut dissocier le fond de la forme, c’est lié, selon ce que va faire le personnage, selon les moments plus ou moins contemplatifs, plus ou moins violents qu’il va vivre, c’est à ce moment que l’écriture va varier. Dans Les cœurs déchiquetés, c’est évident que pour le gamin qui est souvent dans des moments de contemplation, de mélancolie même s’il agit, j’ai évidemment une écriture plus souple, plus chaloupée, plus lyrique que dans les parties où le flic mène son enquête, avec beaucoup plus de dialogues, de l’action, j’en viens à ne pas écrire tout à fait de la même façon. En gros, j’ai l’impression que le style peut commander l’action, selon le style qu’on va adopter y compris pour une scène d’action, de fusillade ou de combat, on va pouvoir la ralentir, la cadrer autrement un peu comme on peut le faire au cinéma, comme ces cinéastes qui chorégraphient certains combats, on peut jouer à ça avec le style, mais de la même façon, s’il y a une scène de violence ou de combat, elle peut aussi tout d’un coup obliger l’écriture à quelque chose de plus cassant, la cuisine se fait entre ces deux nécessités.
BM : Est-ce que cela vous dérange si on dit de vous que vous vous inscrivez dans un certain classicisme, c’est à dire vous n’avez pas peur de faire des phrases, de faire des descriptions alors qu’aujourd’hui les auteurs semblent avoir peur de ça… j’ai l’impression que vous, vous suivez votre écriture, que s’il y a besoin d’une description vous la faites, vous pouvez même prendre votre temps, etc., le fait d’écrire à la troisième personne…
HLC : Quand je commence à écrire, j’essaie le présent, le passé, la 1ere, troisième personne pour voir ce qui vient le plus facilement, musicalement, etc. Une fois que j’ai réglé ça je peux y aller, mais c’est vrai que le choix d’écrire au passé, ça donne une prosodie aux phrases totalement différente, l’imparfait allonge la terminaison du verbe, le passé simple est beaucoup plus bref comme son nom l’indique et comme son usage le veut d’ailleurs, à un moment ça pose le texte un petit peu en évitant de le rendre pesant… il y a des descriptions, je ne suis pas un fan, moi aussi quand je lis, parfois ça m’ennuie profondément, mais là on parlait de la nature, à un moment donné on ne peut pas se contenter de dire que les oiseaux chantent, en tout cas, moi je n’ai pas envie, d’autres peuvent le faire, ce n’est pas un problème mais moi je me vois mal le faire, surtout si j’ai envie de montrer l’effet que ça produit chez le personnage, la communion et l’empathie entre lui et le reste, si j’ai envie d’exprimer ça, je suis quand même obligé de le dire, alors oui je n’ai pas peur des phrases. Comme lecteur, je suis fasciné par des auteurs américains qui écrivent sur les grands espaces, qui n’ont pas peur de faire une page sur un horizon montagneux, une forêt, une route qui fuit on ne sait pas où, je trouve ça fascinant, on y est, on est dans le film, ça convoque des images aussitôt, j’adore ça comme lecteur. En écrivant je me dis pourquoi je n’essaierais pas d’abord de me faire ce petit plaisir là, voir ce que ça donne, et si ça fonctionne et que le lecteur est prêt à le recevoir, qu’il en profite. A côté de ça, là je commence un nouveau roman qui débute par une descente de police, un groupe de flics qui se comportent fort mal, et là au contraire, j’écris au présent, je fais une narration très castagnée, très cassée, j’adore ça, mais je sais que pour d’autres chapitres, j’aurais d’autres voix narratives, ou là c’est un autre personnage et je vais plus prendre mon temps. Entre la brutalité du policier auquel je pense et des deux autres personnages principaux qui sont une fois de plus dans la perte, j’écrirai différemment, ça me paraît normal. J’aime bien le mot expressionnisme, j’aime bien l’expressionnisme en peinture, j’aime bien l’expressionnisme au cinéma, évidemment le cinéma allemand, mais aussi le film noir, ce sont des films expressionnistes, et je crois que j’aime bien ça, ce qui n’empêche pas la nuance…
BM : Et donc quelque part, c’est l’histoire, les personnages qui vous dictent la scène et le style, plus que le style…
HLC : Ça vient un peu à l’instinct, il y a des écrivains, moi j’admire ça qui ont une voix et qui la pose quelque soit l’histoire qu’ils racontent. Moi je me laisse guider par l’histoire avec mon savoir-faire tout en essayant de construire quelque chose le plus en harmonie possible.
BM : Comment vous situez-vous dans le polar français ?
HLC : Pour mes trois premiers romans j’avais l’impression et le désir de me situer dans ce qui se faisait à l’époque, le néopolar, le polar d’intervention directe, de témoignage ou de reflet. Mon défaut a été de peut-être trop vouloir faire comme les autres, comme les copains, j’ai eu de façon adolescente l’impression d’adhérer à un grand syndicat, c’est une illusion, c’est idiot, on est seul quand on écrit, on peut rencontrer des solidarités mais c’est pas du même ordre, donc j’étais un peu naïf et je suis arrivé à une impasse à un moment donné, ça ne m’intéressait plus d’écrire ça. J’ai eu une vrai crise, une remise en cause, qu’est-ce que je fous là ? Est-ce que je continue d’écrire parce qu’après tout il n’y a pas que ça dans la vie ? Un vrai blocage, je venais d’écrire trois bouquins sur Bordeaux et la ville commençait par me sortir par les trous de nez, j’en pouvais plus, j’avais l’impression d’étouffer dans mon travail d’auteur, dans cette ville dont j’arrivais plus à exprimer ce que je voulais lui faire dire. Je m’aperçois que ça ne sert à rien de vouloir faire parler les villes, si elles veulent parler, elles parlent toutes seules, donc il faut s’occuper d’autre chose, ne pas avoir de présupposé au départ. Pendant deux, trois ans, j’ai fait des essais, des trucs, des machins, en plus les manuscrits me revenaient refusés donc avec des avis, des notes de lecture qui étaient assez durs, je me suis dit là il faut vraiment réfléchir, et j’avais cette idée de Lautréamont qui trainait depuis un moment, je me suis dit essayons voir, si j’arrive à faire ça, je devrais arriver à faire le reste. Je me suis mis au boulot, c’était un boulot de quatre, cinq ans, entre la documentation et l’écriture, j’ai appris une foule de choses, j’ai adoré écrire ce bouquin et pour l’instant, ça m’a remis un peu sur les rails, ça m’a redonné l’envie, une vraie envie, un vrai désir d’écrire, et puis changer, ne pas écrire le même truc, les deux derniers sont différents, le prochain le sera encore…
BM : Est-ce que vous lisez les autres auteurs…
HLC : J’ai toujours lu mes collègues français, et les étrangers bien sûr, à l’époque où j’ai commencé à écrire un peu dans cette quête d’identification que j’avais un peu bête. Je lis toujours, je lis les petits nouveaux de la série noire avec passion, désarroi parfois, je me pose des tas de question, mais dans le polar français je pense qu’il y a là une voie nouvelle, quelque chose qui est en train de se passer, je ne suis pas obligé d’adorer ça tout le temps, mais à l’évidence, il y a là des voix qui commencent à s’élever et ça je trouve ça intéressant. Je lis mes copains de chez Rivages, Oppel, Dessaint, je les aime bien comme individus mais aussi ils ont des œuvres qui commencent à avoir un certain poids, puis après d’autres gens dont les noms ne me viennent pas à l’esprit. Je suis curieux et je ne lis pas que du polar, j’aime lire Pierre Michon, Jean Echenoz, j’ai adoré lire Hubert Mingarelli, j’adore ce mec… je trouve que c’est un bel écrivain. J’aime lire certains auteurs qui ont une écriture ironique qui teinte de façon aiguë à l’oreille ou comme Mingarelli qui ont une écriture plus humaine, et qui n’écrit pas des romans noirs mais la façon dont il pose ses histoires, c’est un petit peu la façon dont moi et d’autres nous essayons de situer nos livres…
BM : J’ai l’impression qu’à une époque le roman noir devenait trop explicatif, trop un discours et que maintenant on est un peu dans l’excès inverse, un peu trop de cynisme, trop de nihilisme…
HLC : Vous me demandiez ce que je pensais… à un moment donné je n’arrivais plus à lire les collègues, je n’y arrivais plus, si on veut témoigner à ce point-là de la société, etc. il vaut mieux faire du journalisme, écrire des romans, des livres de reportage, les journalistes ne le font pas assez, c’est bien que les écrivains s’en chargent. Mais je ne pouvais plus supporter ces romans qui obéissaient à une idée préconçue « voilà je vais parler de ça » et qui mettent au service de leur quête, de leur dénonciation une vague intrigue romanesque et ce n’était pas bon sur le plan journalistique, et nul sur le plan romanesque, on se retrouve le cul par terre quand on lit ça et à un moment donné, ça a été l’impasse, ça continue, il y a encore des séquelles de ça, je crois que là le néopolar il arrivait au bout. Après je parlais de ce qui se produit à la Série Noire ou ailleurs, je n’en lis pas assez pour être juge, là oui, il y a une espèce de retour de manivelle, le polar français s’est tellement caricaturé dans une politisation qui est légitime mais pas dans le champ littéraire, s’il faut faire des combats, des manifs, affronter qui on veut, il n’y a pas souci pour moi, ce sont mes convictions en plus, tout ça. Mais je trouve qu’à un moment donné le champ littéraire doit avoir une part d’autonomie, je ne suis pas non plus pour l’artiste détaché de tout, dans sa tour d’ivoire mais si on veut être citoyen, militant, on peut l’être par mille autre façons. Dans un bouquin, ça peut être vite chiant, il faut arrêter ça et maintenant on en revient à un truc, « on s’en fout de tout, no futur », j’ai envie de leur dire que les punks l’ont déjà dit, qu’ils sont un peu morts, ce n’est pas eux qui ont empêché Thatcher de fracasser la société britannique, il faut peut-être arrêter de se la jouer là-dessus. C’est un peu dommage, et ça provoque dans le petit monde du polar français qui aime bien la polémique à deux balles, les débats pourris, je me rappelle l’article de Lire sur Chainas et je ne sais plus qui, sur le nouveau nihilisme, etc. Et alors il y a la vieille fraction rouge qui gueule et les jeunes qui en rajoutent dans la provoc, il faut arrêter, ça n’intéresse personne, il vaut mieux qu’on écrive des bouquins et si on veut faire bouger, secouer le cocotier, il y a la rue, il y a plein d’endroits…
BM : Pour finir quelles sont vos projets ?
HLC : A une époque je n’aimais pas en parler, mais maintenant j’ai moins peur, c’est une histoire qui se passera à Bordeaux, hein tant pis !, dans les années 50, avec des personnages qui sont dans la convergence entre le souvenir de la Shoah et l’actualité barbare et violente de la guerre d’Algérie. Je vais essayer de faire percuter ces deux horreurs là, je ne sais pas ce que ça va donner, c’est une chantier assez effrayant.